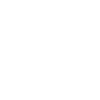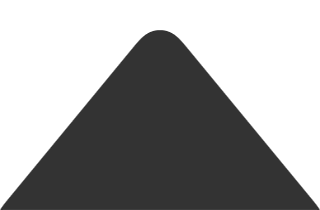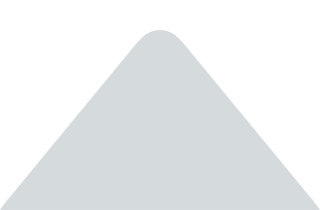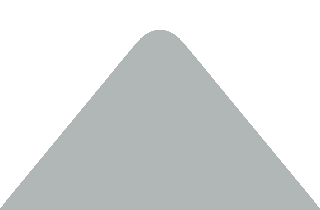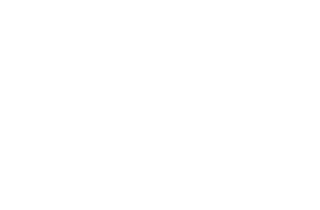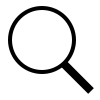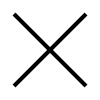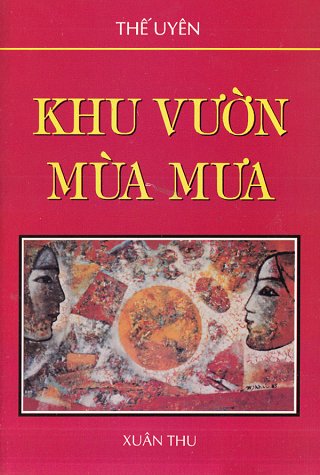EBOOKS » Marquis de Sade » Juliette
TABLE DES MATIÈRES
- Chaprite 1
- Chaprite 2
- Chaprite 3
- Chaprite 4
- Chaprite 5
- Chaprite 6
- Chaprite 7
- Chaprite 8
- Chaprite 9
- Chaprite 10
- Chaprite 11
- Chaprite 12
- Chaprite 13
- Chaprite 14
- Chaprite 15
- Chaprite 16
- Chaprite 17
- Chaprite 18
- Chaprite 19
- Chaprite 20
- Chaprite 21
- Chaprite 22
- Chaprite 23
- Chaprite 24
- Chaprite 25
- Chaprite 26
- Chaprite 27
- Chaprite 28
- Chaprite 29
- Chaprite 30
- Chaprite 31
- Chaprite 32
- Chaprite 33
- Chaprite 34
- Chaprite 35
- Chaprite 36
- Chaprite 37
- Chaprite 38
- Chaprite 39
- Chaprite 40
- Chaprite 41
- Chaprite 42
- Chaprite 43
- Chaprite 44
- Chaprite 45
- Chaprite 46
- Chaprite 47
- Chaprite 48
- Chaprite 49
- Chaprite 50
- Chaprite 51
- Chaprite 52
- Chaprite 53
- Chaprite 54
- Chaprite 55
- Chaprite 56
- Chaprite 57
- Chaprite 58
- Chaprite 59
- Chaprite 60
 BOOK COMMENTS
BOOK COMMENTS
0.0/7 - 0 rating